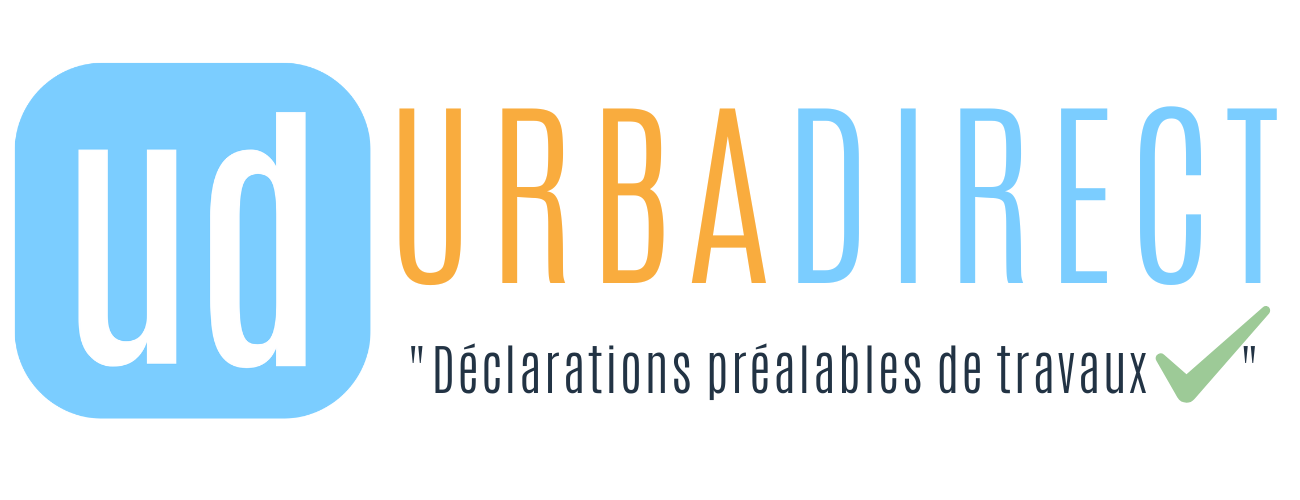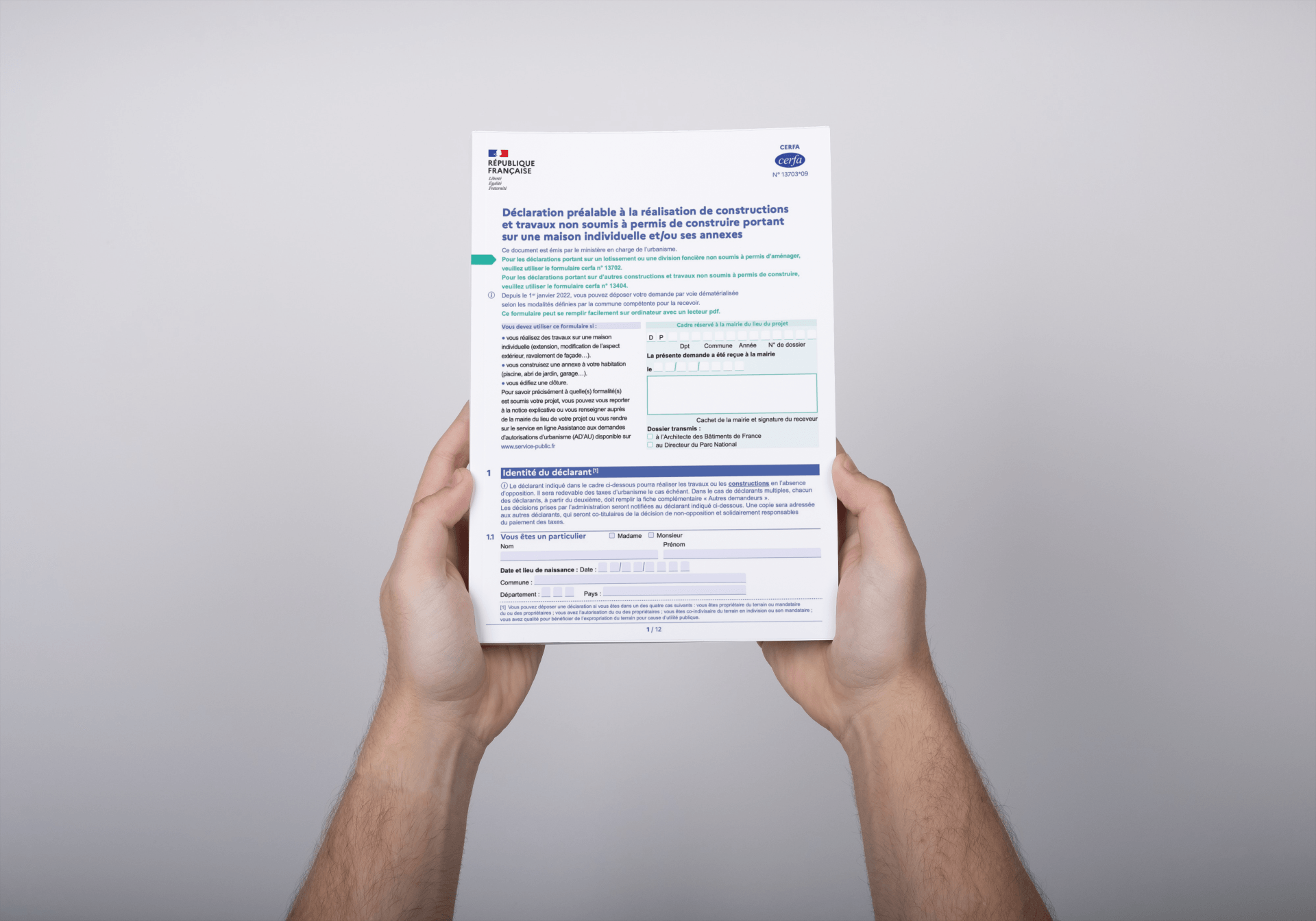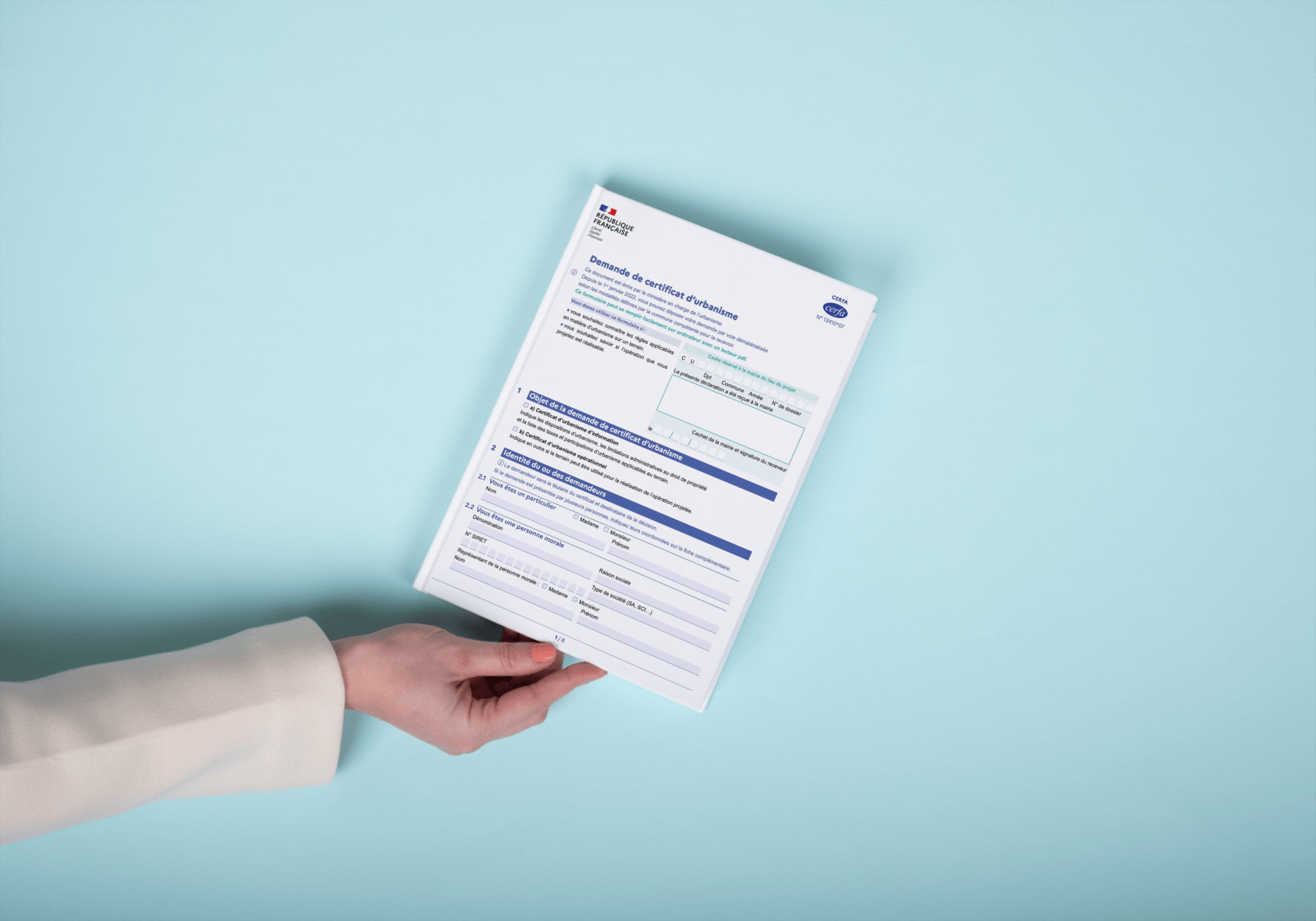Projet « Foncier Innovant » en 2025 : l’IA du fisc traque piscines, vérandas et autres constructions non déclarées
Depuis 2023, l’administration fiscale française déploie un ambitieux programme de détection automatisée des constructions non déclarées, baptisé Projet Foncier Innovant. Basé sur l’analyse d’images aériennes et l’intelligence artificielle, ce dispositif a déjà fait parler de lui en identifiant des milliers de piscines « oubliées » par leurs propriétaires dans les déclarations. Fort de ce succès, l’État étend en 2024-2025 la surveillance à d’autres aménagements comme les vérandas, garages ou abris de jardin. Cet article fait le point sur le fonctionnement de cet outil, les obligations légales d’urbanisme et de fiscalité pour les particuliers, les risques en cas d’oubli et les solutions pour régulariser sa situation avant de subir des sanctions. Nous adopterons un ton pédagogique et factuel, afin d’alerter sans alarmisme sur l’importance d’anticiper plutôt que de subir.
Le « Projet Foncier Innovant » : quand le fisc utilise l’IA pour contrôler le foncier
Qu’est-ce que le Projet Foncier Innovant ? Lancé en 2021 par le ministère de l’Économie, ce programme permet à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) d’utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle open source pour analyser les photos aériennes de l’IGN (Institut national d’information géographique) et repérer des constructions ou aménagements non déclarés. Concrètement, le logiciel détecte sur les orthophotos les contours des bâtiments et des piscines et compare ces informations aux données cadastrales et déclarations connues. Si un élément construit apparaît sur les images sans correspondance dans les bases fiscales, il est signalé comme anomalie. Chaque anomalie est ensuite vérifiée manuellement par un agent fiscal avant d’engager des démarches auprès du propriétaire. L’objectif affiché est de renforcer l’équité fiscale en imposant justement tous les biens construits, et de fiabiliser au passage le plan cadastral.
Des premiers résultats spectaculaires sur les piscines. Le projet a débuté par une phase d’expérimentation en 2022 ciblant les piscines non déclarées, dans 9 départements pilotes (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire et Vendée). Les algorithmes, entraînés à reconnaître la forme caractéristique des bassins bleus, ont permis d’identifier des milliers de piscines « oubliées ». Après vérification et relance des propriétaires, plus de
20 000 piscines non déclarées ont été confirmées et intégrées dans l’assiette de la taxe foncière en 2022. Pour cette seule année dans les zones test, cela a généré près de
10 millions d’euros de recettes fiscales supplémentaires au profit des communes concernées. Fort de ce succès, le dispositif a été
généralisé en métropole fin 2022 - début 2023. Selon le directeur de la DGFiP, Jérôme Fournel,
plus de 120 000 piscines non déclarées ont pu être détectées au niveau national, avec un redressement moyen d’environ 375 € par piscine, représentant
40 à 50 millions d’euros de taxes foncières additionnelles en 2023. Autrement dit, le fisc a rempli les caisses des collectivités locales grâce à cet outil innovant, tout en rappelant les propriétaires à leurs obligations. À titre d’illustration, la taxe foncière due pour une piscine est d’environ 285 € par an en moyenne, et les propriétaires indélicats se sont vus réclamer les années non payées.
Images publiques et algorithmes open source. Il est intéressant de noter que le dispositif s’appuie uniquement sur des données publiques et transparentes. Les vues aériennes utilisées proviennent du portail public Geoportail de l’IGN, que chacun peut consulter librement en ligne. En d’autres termes, les propriétaires eux-mêmes peuvent visualiser leur terrain sur ces photos haute résolution, tout comme le fait l’algorithme. Les modèles d’IA développés pour le Projet Foncier Innovant utilisent des briques technologiques open source, et la DGFiP assure conserver la maîtrise totale des traitements et des données produites. Des entreprises privées ont été impliquées pour la phase de développement (notamment Capgemini en assistance maîtrise d’ouvrage et Google pour la mise à disposition de l’infrastructure cloud et d’outils IA), mais l’administration insiste sur la confidentialité des données fiscales et le fait que seuls les contours géographiques des constructions sont extraits des images pour être recoupés avec le cadastre. La protection de la vie privée a donc été prise en compte, l’IA ne « voit » que des formes de bâtiments et non des personnes.
Abris, vérandas, garages… L’extension de la traque à d’autres constructions en 2024-2025
Nouvelles cibles du fisc en 2024. Après les piscines, Bercy a annoncé étendre son œil numérique à d’autres aménagements non déclarés du bâti. Dans le collimateur figurent désormais des extensions courantes de nos maisons : vérandas, garages, abris de jardin, pergolas,« les bâtis non déclarés d’environ 50-60 m² », selon la DGFiP. En bref, tout ce qui peut augmenter significativement la surface ou la valeur d’un bien immobilier. La DGFiP a explicitement indiqué qu’elle comptait « maximiser l’utilisation de [son] nouvel outil et continuer à collecter les impôts, qui sont au cœur de [sa] mission » en ciblant ces structures jusqu’ici « dissimulées » dans de nombreux jardins. Dès fin 2023, l’administration préparait une phase de détection expérimentale des extensions non déclarées, avec un lancement du contrôle automatisé début 2024 dans quelques départements pilotes, avant une généralisation progressive à l’ensemble du territoire. Autrement dit, la chasse ne fait que commencer : après les piscines, vérandas et annexes non déclarées seront les prochaines sur la liste.
Quels types de travaux sont visés exactement ? Il est important de souligner que toutes les constructions ne sont pas concernées par ces contrôles. Les petits aménagements légers ou temporaires ne tombent pas dans le champ d’application. Par exemple, un abri de jardin de moins de 5 m² (surface au sol) n’exige aucune autorisation d’urbanisme et échappera à la fois à l’obligation de déclaration et aux radars du fisc. Seules les constructions pérennes et suffisamment grandes pour être aménageables ou habitables sont dans le viseur. En pratique, cela correspond aux ouvrages qui nécessitent l’obtention d’un permis de construire et sont soumis à la taxe d’aménagement et à la taxe foncière. On retrouve ainsi les règles bien connues du Code de l’urbanisme :
- Moins de 5 m² créés : aucune démarche nécessaire*, ni permis ni déclaration (exemple : un tout petit cabanon démontable).
- Entre 5 m² et 20 m² construits (jusqu’à 40 m² dans certaines zones urbaines couvertes par un PLU) : il faut déposer une
déclaration préalable de travaux en mairie. La mairie a 1 mois pour éventuellement s’y opposer (délai porté à 2 mois en secteur protégé).
- Au-delà de 20 m² ajoutés (ou 40 m² en zone PLU sous conditions) : un
permis de construire est requis, avec un délai d’instruction de 2 à 3 mois selon les cas.
*hors abords de monuments historiques, secteurs sauvegardés, sites patrimoniaux remarquables.
En outre, avant toute construction, il est vivement conseillé de consulter le
plan local d’urbanisme (PLU) de votre commune. Ce document d’urbanisme peut imposer des règles précises (hauteur maximale, distance aux voisins, esthétique des façades, matériaux, couleurs, etc.) ou même
interdire certains aménagements dans votre zone. Par exemple, toutes les communes n’autorisent pas librement l’ajout d’une véranda ou la construction d’un abri en limite de propriété ; mieux vaut se renseigner en mairie pour éviter de réaliser des travaux non conformes qui seraient impossibles à légaliser par la suite.
Un algorithme encore perfectible. Repérer automatiquement une piscine bleue sur une photo aérienne est une chose, détecter une véranda adossée à une maison en est une autre. Les spécialistes préviennent que le logiciel pourrait rencontrer plus de difficultés (et commettre plus d’erreurs) avec ces nouveaux objets, dont la forme se fond parfois dans l’existant. Les vérandas, pergolas ou extensions se présentent sous des apparences variées (toits en verre, tonnelles, agrandissements attenants…) pas toujours faciles à distinguer du bâtiment principal sur une vue du dessus. D’ailleurs, un syndicat des agents du cadastre souligne qu’aucun algorithme fiable n’est encore capable d’identifier sans ambiguïté une véranda ou un agrandissement sur photo : le déploiement de ce volet du projet pourrait
prendre du retard en attendant des techniques plus matures. Néanmoins, la DGFiP semble prête à améliorer ses modèles au fil de l’eau, quitte à accepter un certain
taux de « faux positifs ». Une note interne révélée par le syndicat Solidaires FiPublik indique qu’il est « pleinement assumé [d’avoir] des taux de validation plus faibles, incluant une part de rejets parfois significative, […] contrepartie d’une volonté de ne pas écarter abusivement des détections “fiscalisables” ». En clair, le fisc préfère
trop détecter que pas assez, au risque de confondre une bâche bleue avec l’eau d’une piscine ou une tente de stockage avec un garage. Ces éventuelles erreurs seront ensuite filtrées lors de la vérification humaine, mais elles pourront causer des
démarches inutiles pour des propriétaires de bonne foi. Ce parti pris suscite des interrogations éthiques et juridiques : jusqu’où l’administration peut-elle aller dans l’automatisation, quitte à inquiéter des particuliers n’ayant rien dissimulé volontairement ? Nous y reviendrons plus loin.
Ce que dit la loi : autorisations d’urbanisme et déclarations fiscales obligatoires
Avant de parler des sanctions, il convient de rappeler les obligations légales qui incombent à tout propriétaire réalisant des travaux. Deux volets sont à considérer : le volet urbanisme (démarches en mairie) et le volet fiscal (déclaration aux impôts). Beaucoup de particuliers ignorent ces formalités, ce qui peut les conduire involontairement dans l’illégalité.
Obligations d’urbanisme (mairie). En France, la règle générale est que toute construction ou modification de construction doit faire l’objet d’une autorisation préalable, à l’exception des menus travaux listés par la loi. Comme vu ci-dessus, dès que votre projet crée plus de 5 m² de surface au sol (ou modifie l’aspect extérieur, comme une lucarne sur le toit), vous devez au minimum déposer une déclaration préalable (DP) de travaux en mairie. Pour les agrandissements plus importants, un permis de construire (PC) est requis. Ces autorisations d’urbanisme permettent à la commune de vérifier la conformité du projet aux règles locales et nationales (PLU, Code de l’urbanisme, etc.). Une fois l’autorisation obtenue et les travaux réalisés, il faut signaler la fin du chantier en déposant en mairie une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. Ce document déclenche le délai pendant lequel la commune peut venir contrôler la conformité sur site (généralement 3 mois
après dépôt d’achèvement, passé lequel l’ouvrage est considéré comme légalement établi).
Faute d’autorisation, les travaux sont réputés illégaux et le propriétaire s’expose d’emblée à des poursuites pénales (voir section suivante). Il en va de même si l’on a obtenu un permis mais qu’on ne l’a pas respecté (par exemple extension plus grande que prévu, non respect des plans…).
Obligations fiscales (déclaration aux impôts). Indépendamment des démarches en mairie, toute nouvelle construction ou agrandissement doit être déclaré à l’administration fiscale. En effet, ces changements affectent la valeur locative cadastrale de votre bien, base de calcul des impôts locaux (taxe foncière et, le cas échéant, taxe d’habitation). L’article 1406 du Code général des impôts prévoit ainsi que les propriétaires déclarent les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d’affectation de leurs propriétés. Le délai est très clair : vous disposez de 90 jours après l’achèvement des travaux pour signaler la nouvelle construction au fisc. Cette déclaration se fait en ligne, depuis votre espace particulier sur impots.gouv.fr, via le service « Biens immobiliers ». Il suffit de sélectionner le bien concerné et de remplir la fiche de déclaration foncière en indiquant la nature des travaux, la date d’achèvement, la surface créée, etc.. Pour les personnes n’ayant pas internet, une alternative papier existe avec les formulaires Cerfa dédiés : par exemple le formulaire n°6704 IL (« changement de consistance ou d’affectation des propriétés bâties ») permet de déclarer une piscine, un aménagement de combles ou toute extension de surface. De même, le formulaire modèle H1 sert pour déclarer une maison individuelle nouvellement construite (ou une extension de maison). Ces formulaires peuvent être envoyés au centre des impôts fonciers de votre secteur.
Un “bonus” si vous déclarez spontanément : pourquoi respecter ce délai de 90 jours ? D’une part, bien sûr, pour être en règle. Mais d’autre part, la loi prévoit un avantage fiscal si vous jouez le jeu de la déclaration spontanée : toute construction nouvelle dûment déclarée dans les 90 jours bénéficie d’une exonération de taxe foncière pendant 2 ans! En effet, les immeubles neufs (ou nouveaux bâtis ajoutés) sont exonérés de taxe foncière les deux premières années qui suivent leur achèvement, à condition que le propriétaire ait rempli la déclaration dans les temps. Cet avantage, accordé par le Code des impôts (articles 1383 et suivants), vise à ne pas alourdir immédiatement la charge fiscale suite à un investissement immobilier. Par exemple, si vous construisez une véranda terminée en juin 2025 et que vous la déclarez avant septembre 2025, vous ne paierez la taxe foncière sur cette extension qu’à partir de 2027. En revanche, si vous omettez de déclarer dans les 90 jours, vous perdez ce droit à exonération et l’administration pourra vous réclamer la taxe dès l’année d’achèvement, sans remise possible.
Comment le fisc vous retrouve en cas d’oubli : malgré ces incitations, beaucoup de propriétaires omettent la déclaration fiscale, par ignorance ou négligence. Jusqu’ici, l’administration fiscale ne pouvait découvrir ces « oublis » qu’à l’occasion de vérifications ponctuelles ou de signalements. Mais avec le Projet Foncier Innovant, le fisc dispose d’une arme de détection massive. Comme expliqué précédemment, les images aériennes croisées avec le cadastre permettent d’identifier tôt ou tard toute construction notable non déclarée. Si les services fiscaux détectent chez vous une piscine, une extension ou un bâtiment non déclaré, ils vous enverront un courriel ou courrier vous invitant à régulariser votre situation. Dans ce cas, vous aurez 30 jours à compter de la réception du mail pour effectuer la déclaration manquante – en ligne via « Biens immobiliers » ou par formulaire. C’est exactement ce qui a été mis en œuvre pour les piscines en 2023 : plus de 120 000 propriétaires ont reçu ce genre de notification les sommant de déclarer leur piscine non mentionnée jusque-là. Mieux vaut ne pas ignorer cet avertissement, car passé le délai imparti, l’administration passera à l’étape de taxation d’office et de sanctions.
Oublier de déclarer, quels risques ? – Redressements fiscaux et amendes en perspective
Que se passe-t-il concrètement si vous avez réalisé des travaux sans autorisation d’urbanisme et/ou sans déclaration fiscale ? Il faut distinguer les sanctions d’urbanisme (pénales) et les sanctions fiscales, qui peuvent se cumuler.
Sanctions pour infraction d’urbanisme. Du point de vue du droit de l’urbanisme, construire sans autorisation (ou en violation d’une autorisation) est une infraction pénale. L’article L480-4 du Code de l’urbanisme prévoit une amende comprise entre 1 200 € minimum et jusqu’à 6 000 € par m² de surface illégalement construite. Le total de l’amende peut donc atteindre des sommes considérables (avec un plafond légal d’environ 300 000 € pour les personnes physiques). En cas de récidive, une peine de prison pouvant aller jusqu’à 6 mois est également prévue, même si dans les faits les emprisonnements pour ce motif sont rarissimes. Ces peines concernent le propriétaire bénéficiaire des travaux, mais aussi potentiellement l’artisan ou l’architecte complices qui ont réalisé le chantier irrégulier. Par ailleurs, le tribunal correctionnel saisi d’une telle infraction peut ordonner la démolition ou la mise en conformité de la construction illégale, aux frais du propriétaire. Il peut aussi imposer une astreinte (par exemple 500 € par jour de retard) tant que les travaux de démolition/remise en état ne sont pas exécutés. En somme, sur le papier la loi est très dissuasive : une véranda non déclarée de 20 m² pourrait théoriquement valoir 120 000 € d’amende et la destruction de l’ouvrage si le juge estimait la violation grave. Heureusement, il existe un délai de prescription en matière pénale d’urbanisme : 6 ans après l’achèvement des travaux. Passé ce délai, plus aucune poursuite pénale n’est possible (sauf en cas de récidive avec de nouveaux travaux similaires). C’est pourquoi on entend souvent dire qu’« au bout de 10 ans on ne risque plus rien » – en réalité 6 ans pour le pénal, et 10 ans au civil pour qu’un voisin ou la commune ne puissent plus contester l’irrégularité. En pratique, si vos travaux non déclarés datent de plus de 6 ans, vous ne risquez plus d’amende judiciaire ni de démolition forcée à l’initiative du procureur. Toutefois, attention : "Cette prescription ne s’applique pas lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis n’ait été obtenu alors qu’il était requis."
Autrement dit, la prescription ne protège pas les constructions qui n’ont jamais eu d’autorisation au départ, comme une maison construite sans permis.En revanche, elle peut s’appliquer aux petits travaux non déclarés (véranda, abri, extension) réalisés sur une maison qui, elle, a été autorisée.Dans ce cas, si les travaux ont plus de 6 ans (pénal) ou 10 ans (administratif), ils ne bloquent plus automatiquement un nouveau projet… sauf si leur régularisation est impossible (ex : non-conformité au PLU).
C’est la redoutée jurisprudence Thalamy.
Sanctions fiscales et redressements. Sur le plan fiscal, ne pas déclarer une construction revient à minorer la base imposable, donc à éluder des impôts locaux. Que le bâtiment soit légal ou non du point de vue urbanistique n’a pas d’incidence : même une construction illégale est taxable (le fisc se moque de savoir si vous aviez le droit de la construire, il veut sa part malgré tout). Ne pas déclarer constitue donc une fraude fiscale au sens de la loi. Si l’administration s’aperçoit de l’oubli, elle va procéder à un rattrapage des impôts dus, potentiellement sur plusieurs années en arrière. Concrètement, pour la taxe foncière, le fisc a la possibilité de réclamer jusqu’à 4 années d’imposition non payées. C’est ce qui a été appliqué pour les piscines non déclarées : lors de la régularisation en 2023, les propriétaires concernés ont payé la taxe foncière 2023 augmentée rétroactivement jusqu’à 4 fois en fonction de la date de construction de la piscine. Autrement dit, s’ils avaient la piscine depuis plus de 4 ans, ils ont dû acquitter quatre années d’un coup (2019 à 2022) en plus de 2023. Quatre ans est le maximum, correspondant au délai de prescription fiscale de droit commun (on retrouve la « règle des 4 ans » pour la plupart des impôts locaux). S’ajoutent à cela des intérêts de retard (environ 0,20% par mois de retard) et possiblement des majorations pour défaut de déclaration. En matière fiscale, la pénalité standard pour absence de déclaration dans les délais après mise en demeure est de 40% des sommes dues, et elle peut grimper à 80% en cas de manœuvres frauduleuses avérées (article 1729 du CGI). Dans les faits, l’administration peut faire preuve de clémence si le contribuable coopère dès la première relance : pour les piscines, une simple majoration de 10% pour retard de paiement a pu être appliquée dans nombre de cas, selon les retours observés. Mais il ne faut pas s’y tromper : juridiquement, le fisc est en droit de sévir lourdement, car ne pas déclarer une extension est assimilé à de la fraude et non à une simple omission.
Il ne faut pas oublier non plus la taxe d’aménagement. Cette taxe d’urbanisme, distincte de la taxe foncière, est due à la réalisation de toute construction ou agrandissement soumis à autorisation (elle est perçue une fois, au moment de la construction, au profit de la commune et du département). Normalement, elle est liquidée sur la base du formulaire de permis ou de déclaration de travaux. Si vous avez construit sans déclaration, vous avez donc éludé la taxe d’aménagement. Lors d’une régularisation a posteriori, la note peut être salée : la loi prévoit que la taxe d’aménagement due en cas de construction sans permis est majorée de 80% (c’est l’article L331-23 du Code de l’urbanisme). En clair, vous paierez la taxe d’aménagement normale calculée sur votre construction, augmentée de 80% de pénalité. Cette majoration vise à sanctionner financièrement ceux qui auraient tenté de se soustraire à l’impôt en construisant dans leur coin. Par exemple, une véranda de 20 m² dans une commune avec un taux de taxe d’aménagement modéré pourrait normalement générer 1 000 € de taxe ; en régularisation tardive, cela grimperait à 1 800 €. La somme est exigible en une seule fois lors de la délivrance du permis de régularisation ou de la décision de la mairie. Notons que si les travaux réalisés datent de plus de 6 ans, la commune ne pourra plus légalement poursuivre au pénal ni forcer à démolir, mais la taxe d’aménagement, elle, reste due sans condition de délai – toutefois, au-delà de 4 ans l’action en recouvrement fiscale se prescrit, ce qui peut limiter le rattrapage possible.
En résumé, un propriétaire pris en flagrant délit de travaux non déclarés risque un double effet Kiss Cool : d’un côté des amendes et sanctions urbanistiques potentiellement lourdes (bien qu’encadrées par des délais de prescription), de l’autre un redressement fiscal avec rappel des taxes sur 4 ans, intérêts et pénalités. Le tout peut s’accompagner, en cas de mauvaise volonté, d’une majoration pour fraude de 80% sur les impôts éludés. Et l’algorithme de Bercy, lui, ne fait pas la distinction entre fraude délibérée et simple ignorance : toute anomalie détectée est traitée de la même manière. C’est là qu’intervient une vraie problématique d’équité sociale. Des ménages de bonne foi, qui ont agrandi leur maison sans savoir qu’il fallait remplir un formulaire H1 ou payer quelques centaines d’euros de taxe, se retrouvent mis dans le même sac que des fraudeurs volontaires ayant sciemment caché une dépendance entière. Les conséquences financières peuvent être douloureuses pour ces « oublieux » de bonne foi, d’où l’importance de renforcer l’information et l’accompagnement, plutôt que de frapper aveuglément.
Travaux non déclarés : attention aux impacts sur la vente de votre bien immobilier
Outre les sanctions immédiates, une construction non déclarée peut vous rattraper plus tard, au moment de vendre votre maison. C’est un aspect parfois négligé : même si vous passez entre les mailles du filet fiscal, le jour où vous trouvez un acheteur, celui-ci (et son notaire) va éplucher la situation administrative du bien.
Obligation d’information de l’acheteur. Lors d’une vente immobilière, le vendeur a l’obligation légale de déclarer tout élément susceptible d’affecter la décision de l’acquéreur. Des travaux réalisés sans permis ou sans déclaration en font partie. Concrètement, si vous avez aménagé une extension sans autorisation, vous devez le signaler à l’acquéreur potentiel dès la signature du compromis. En général, les notaires intègrent une clause indiquant si des travaux non conformes ont été effectués. Ne pas révéler une véranda non déclarée serait prendre un risque juridique sérieux. En effet, si l’acheteur découvre après coup qu’une partie du bien est illégale, il pourrait intenter une action pour “vice caché” et faire annuler la vente ou obtenir des dommages-intérêts. La jurisprudence considère qu’une extension réalisée sans autorisation, non divulguée lors de la vente, constitue un vice caché affectant le bien, justifiant potentiellement l’annulation de la transaction.
Régularisation avant vente ou vente « en l’état » ? Deux options se présentent généralement. La première, recommandée, est de régulariser administrativement la construction avant la vente. Cela implique de déposer un permis de construire « a posteriori » (ou une déclaration préalable si l’ampleur correspond) pour les travaux déjà faits. La mairie instruira le dossier comme s’il s’agissait de nouveaux travaux – avec le risque de refus si la construction n’est pas conforme aux règles d’urbanisme. Dans l’intervalle, on peut conditionner la vente à l’obtention de cette autorisation (clause suspensive dans le compromis). Si la régularisation est obtenue, le bien devient légal et vendable sans encombre, moyennant le paiement de la taxe d’aménagement majorée de 80% évoquée plus haut et la mise à jour de la taxe foncière. La seconde option, plus risquée, est de vendre le bien en l’état, en faisant signer à l’acquéreur une clause par laquelle il « prend le bien avec ses éventuelles infractions d’urbanisme et en assumera la régularisation ». L’acheteur devra alors régulariser par lui-même après acquisition. Il arrive que des acheteurs acceptent, surtout si le bien est très attractif, mais ils exigeront alors en contrepartie une baisse du prix pour compenser les frais et risques qu’ils prennent en charge. Dans tous les cas, transparence et honnêteté sont de mise : tenter de dissimuler des travaux non autorisés à la vente est une mauvaise idée qui peut conduire à de longs déboires juridiques.
Influence sur la valeur du bien. Un point à considérer est que des mètres carrés non déclarés sont des mètres carrés « fantômes » sur le plan administratif. Sur le marché immobilier, la surface habitable réelle compte évidemment dans le prix, mais si elle n’est pas régulière, cela peut semer le doute chez l’acheteur. Certains refuseront de valoriser une partie illégale du bien, ou demanderont une décote. Par ailleurs, un banquier accordant un prêt immobilier pourra tiquer s’il apprend qu’une partie de la maison n’est pas aux normes administratives. En cas de sinistre (incendie, effondrement), l’assurance pourrait aussi refuser d’indemniser la partie non autorisée. Bref, régulariser n’est pas seulement une question de conformité : c’est aussi valoriser pleinement son patrimoine et sécuriser une future transaction.
Anticiper et régulariser : nos conseils pour éviter les sanctions
Face à ce panorama potentiellement anxiogène, le mot d’ordre est anticipation. Mieux vaut prévenir les ennuis en régularisant sa situation en amont, plutôt que d’attendre la lettre du fisc ou le conflit à la revente. Voici les bonnes pratiques et solutions à connaître :
- Renseignez-vous avant de construire. Avant d’entreprendre des travaux, passez en mairie consulter le service urbanisme. Vérifiez si votre projet requiert une autorisation (DP ou PC) et si le PLU local impose des contraintes. Les formulaires Cerfa et notices explicatives sont disponibles en mairie ou sur internet pour monter votre dossier. En cas de doute sur le régime applicable, n’hésitez pas à demander un permis même si vous pensez être en dessous des seuils : aucune autorisation ne sera délivrée pour un projet qui n’en a pas besoin, mais au moins vous aurez la certitude d’être en règle. Par exemple, si vous faites une déclaration préalable de travaux pour un abri de jardin de 4 m², la mairie vous répondra qu’aucune autorisation n’est nécessaire* et classera la demande sans suite (sans frais). Mais si vous construisez sans rien demander en pensant avoir le droit alors que le seuil était dépassé, vous serez en infraction. Donc mieux vaut un dossier « pour rien » qu’une infraction par excès de confiance.
*hors abords de monuments historiques, secteurs sauvegardés, sites patrimoniaux remarquables.
- Déclarez systématiquement vos travaux aux impôts dans les 90 jours. Que vous ayez ou non eu besoin d’un permis en mairie, pensez à la
déclaration fiscale post-travaux. Beaucoup de propriétaires l’ignorent : agrandir sa maison ou construire une dépendance
augmente vos impôts locaux, et c’est à vous de le signaler. Notez bien la date d’achèvement de vos travaux et faites la déclaration dans le délai imparti (en ligne via
impots.gouv.fr > Espace particulier > Biens immobiliers, ou via le formulaire 6704/H1/H2). Non seulement vous éviterez un redressement, mais en plus vous bénéficierez de 2 ans d’exonération de taxe foncière sur la nouvelle construction. C’est tout bénéfice à court terme, et cela vous met à l’abri d’ennuis futurs. Si vous avez dépassé le délai mais que le fisc ne vous a pas encore détecté, il est toujours préférable de
régulariser spontanément le plus tôt possible. Adressez votre déclaration sans attendre : en cas de contrôle ultérieur, le fisc sera plus indulgent (pas de pénalité pour mauvaise foi) si vous avez déclaré de vous-même, même tardivement.
- En cas d’oubli ancien, prenez les devants pour régulariser. Si vous réalisez que vous avez un « oubli » de déclaration qui date de plusieurs années (ex : une extension faite il y a 5 ans jamais déclarée), ne paniquez pas mais n’attendez pas non plus passivement. Vous pouvez entreprendre une régularisation volontaire. Cela passe généralement par deux étapes : (1) Réaliser une étude de régularisation* ; (2) obtenir une autorisation d’urbanisme « rétroactive » pour les travaux (si aucune n’avait été demandée) ; (3) déclarer aux impôts et payer ce qui est dû.
*Avant d’engager des démarches administratives, il est essentiel de vérifier la faisabilité de la régularisation de votre construction au regard du Code de l’urbanisme et PLU.
Pour l’autorisation d’urbanisme, rendez-vous en mairie pour déposer un dossier de permis de régularisation ou de déclaration préalable selon le cas. Indiquez clairement qu’il s’agit de travaux déjà réalisés qu’on souhaite mettre en conformité. La mairie instruira normalement le dossier. Si elle accepte (c’est le cas si votre construction respecte les règles d’urbanisme actuelles), vous aurez sauvé la légalité du bien ; sinon, vous vous exposez à devoir modifier ou démolir la partie non conforme, malheureusement. Une fois le permis rétroactif accordé, vous pourrez fournir cette référence à l’administration fiscale lors de votre déclaration. Vous devrez vous acquitter de la taxe d’aménagement majorée (80%) lors de la délivrance du permis, et le fisc calcule les arriérés de taxe foncière (au maximum 4 ans en arrière) à payer. Certes, cela représente un coût non négligeable, mais cette démarche vous met à l’abri de poursuites pénales (le fait de régulariser n’efface pas l’infraction passée, mais en général l’administration renonce à engager des poursuites une fois la situation réglée). D’ailleurs, l’obtention du permis de régularisation ne suspend pas automatiquement l’amende pénale encourue, mais dans les faits, les tribunaux sont plus cléments lorsque le propriétaire de bonne foi a fait les démarches nécessaires. Mieux vaut tard que jamais !
- Faites-vous accompagner par des professionnels. Les procédures de régularisation peuvent être
complexes et techniques. Plans à fournir, formulaires, calculs de taxes… cela peut dépasser le profane. Sachez qu’il existe des
services spécialisés pour vous aider. Par exemple, la société
URBADIRECT est un cabinet d’urbanisme dédié à la régularisation des travaux non déclarés et à l’obtention des autorisations manquantes. Ces professionnels proposent d’auditer votre situation, de préparer les dossiers de permis ou de déclaration, de réaliser les plans nécessaires via leurs dessinateurs, et d’assurer le suivi administratif jusqu’à l’obtention de l’autorisation.
L’esprit est à la prévention, pas à la délation : il s’agit d’aider les particuliers à se mettre en règle avant d’être sanctionnés. Comme le souligne URBADIRECT, régulariser votre bien immobilier nécessite une étude préalable pour vérifier la conformité aux règles d’urbanisme, et l’accompagnement d’un expert facilite une régularisation
complète de A à Z en toute sérénité. D’autres acteurs peuvent aussi vous conseiller : les
notaires sont de bons conseils (habitués à traiter ces questions lors des ventes), de même que les
architectes ou
bureau d’études pour la partie technique. N’hésitez pas à solliciter ces compétences.
- Utilisez les outils en ligne mis à disposition. Plusieurs plateformes officielles peuvent vous être utiles. Le site
Geoportail (www.geoportail.gouv.fr) permet de consulter les prises de vue aériennes de votre terrain, comme le fait le fisc. Vous pouvez ainsi visualiser ce que l’administration pourrait détecter sur vos parcelles. Le site
cadastre.gouv.fr vous donne accès au plan cadastral : vérifiez si votre extension y figure ou non (bien qu’une mise à jour du cadastre puisse prendre du temps). Sur
impots.gouv.fr, votre espace sécurisé propose le service « Biens immobiliers » pour gérer en quelques clics vos déclarations de propriétés. Vous y retrouverez aussi les formulaires téléchargeables (H1, H2, 6704, etc.) si vous préférez le format papier. Le portail
service-public.fr offre des fiches explicatives très claires sur les démarches à suivre en cas de construction nouvelle ou de travaux non déclarés, et comment les régulariser. Enfin, en cas de doute, vous pouvez contacter directement le
centre des impôts fonciers de votre département ou appeler le
0809 401 401 (numéro national d’information des impôts) pour poser vos questions. Mieux vaut poser une question et se renseigner, plutôt que de rester dans l’ignorance et accumuler les risques.
En conclusion, le Projet Foncier Innovant marque une nouvelle ère dans la gestion du foncier en France. L’administration fiscale s’est dotée d’outils à la pointe de la technologie pour traquer les constructions non déclarées, au nom de la justice fiscale et de l’égalité devant l’impôt. Les premiers résultats sur les piscines montrent un potentiel important de recettes pour les collectivités, mais soulèvent aussi des questions de proportionnalité et de pédagogie envers les contribuables. Il est compréhensible que l’État veuille lutter contre les fraudeurs avérés qui cherchent à s’affranchir de l’impôt. Toutefois, la frontière est parfois floue entre la fraude volontaire et la simple négligence ou méconnaissance des règles par des particuliers de bonne foi. C’est pourquoi il est essentiel d’informer largement les propriétaires sur leurs obligations en cas de travaux, afin qu’ils n’aient pas la mauvaise surprise de découvrir, des années plus tard, qu’ils sont en infraction.
Plutôt que de céder à un discours alarmiste, nous avons voulu ici vous donner les clés pour comprendre ce dispositif et ses implications. Retenez que quasiment toute nouvelle construction fixe (piscine, extension, garage, etc.) doit être autorisée et déclarée, sous peine de sanctions. Si vous avez un doute sur votre situation, n’attendez pas que l’algorithme du fisc ne vous rattrape : prenez les devants et régularisez. Les démarches peuvent sembler lourdes, mais des solutions existent pour vous accompagner. L’enjeu en vaut la chandelle : c’est votre tranquillité d’esprit, la pérennité de votre patrimoine immobilier, et le respect du droit. Anticiper plutôt que subir, voilà la stratégie gagnante face à ce « Big Brother » fiscal d’un nouveau genre. En rendant le droit et les démarches plus accessibles, on peut espérer que chacun pourra se mettre en conformité sereinement, et que la justice fiscale s'exerce dans un esprit d’équité et non de brutalité. En attendant, à vos déclarations !
Sources : Projet Foncier Innovant – DGFiP (impots.gouv.fr); Code de l’urbanisme (art. L480-4); Code de l’urbanisme (art. L331-23, taxe d’aménagement); Service-Public.fr – Impôts locaux et constructions nouvelles; Communiqué DGFiP Jérôme Fournel 13/04/2023; Actualités Le Figaro/Particulier, Neozone; Notaires de Dordogne; Analyse Actu-Juridique.fr; Conseil d’expert Mᵉ Quentin Fourez, notaire; Journal du Net – Travaux non déclarés; Blog URBADIRECT; Union Solidaires Finances Publiques.
URBADIRECT vous aide à y voir clair
Prenez un rendez-vous de 15 minutes avec un conseiller urbadirect pour discuter de votre problème.
AVANT TOUT
📑 CHOISIR LE BON CERFA 📑
L'Étude de Régularisation
🤔 C'est QUOI l'étude de régularisation ?
L’étude de régularisation est une analyse technique, juridique et administrative approfondie permettant de déterminer avec précision si votre construction non déclarée peut être régularisée au regard des règles d’urbanisme locales (PLU, contraintes communales, code de l’urbanisme, etc.).